L’école va reprendre ou non ? En cette période incertaine, l’AGEEM (Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles de l’école publique) m’a demandée, en tant que membre de son conseil scientifique, de réfléchir au travail à entreprendre en mai et juin à l’école. Voici la liste des courses…
Dresser la liste des courses, c’est établir celle des acquisitions et en marquer l’urgence pour de très jeunes, mais aussi pour leurs enseignants, leurs A.T.S.E.M., leurs animateurs et leurs familles.
1
La priorité est de ré-habiter son corps. Les mains, le nez, la bouche ne sont pas dédiés à la capture de virus ! Savoir qu’une maladie peut s’introduire dans son corps est terrifiant et les gestes-barrières sont là pour protéger son intégrité et éviter la maladie. Toutefois qu’adviendra-t-il si ces organes indispensables à la vie biologique, mais aussi à la vie sociale, s’assimilent à des plaies ouvertes à cacher et à soigner ? Le regard en portera les stigmates, lui qui fait évaluer l’opportunité de se rapprocher ou non d’une personne, sans percevoir l’ennemi invisible ?
En somme, il y a des véhicules du virus ou de supports (une main, des gouttelettes, des particules fines…) et un comportement dicté par la compréhension d’un processus qui oriente d’un élément inconnu invisible, à notre corps visible et connu au moyen des sensations que nous en avons.
Un corps créatif doit contrebalancer ce corps contraint. Marcher à des rythmes divers, circuler, danser, peindre, etc. favorise la réappropriation de son corps. L’important est de dévoiler par l’expérience directe ou le document, l’étendue des possibles pour réactiver le désir de les explorer, en se projetant dans une situation différente de celle qui a été subie.
Pour ne suivre qu’une piste ou deux, la main est l’organe de la préhension, mais aussi un instrument créatif hautement sophistiqué. Le port de gants transforme le toucher, l’altère souvent, quand la sensualité de la peau invite au geste, à la caresse, à la découverte d’une forme existante ou au modelage d’une nouvelle. Il en va de même pour la bouche qui peut se cacher et se fermer pour se protéger, mais qui a besoin de s’ouvrir pour parler, chanter, crier, aimer… et de se montrer pour manger, boire.
2
Très vite cependant la vie « courante » va s’émailler de conflits entre ce qui est autorisé en principe, mais pas conseillé par temps de pandémie. Même avec des tous petits, le rappel de l’intérêt créatif des contraintes est possible. Pourquoi ne pas concevoir des circulations au moyen de fils tendus en racontant le mythe d’Ariane ou l’histoire du petit Poucet ? Pourquoi ne pas photographier les visages masqués et raconter les aventures de héros qui détiennent en partie leurs pouvoirs d’une telle dissimulation ?
3
Passons à un autre aspect. Comme il en va pour les personnes, les pratiques ne doivent pas être stigmatisées : le dessin ne sert pas qu’à exprimer ses émotions, représenter le virus, etc. Le versant d’analyse psychologique que son usage peut inciter à emprunter n’est pas le fait de l’enseignement. En revanche, la construction de compétences et de connaissances, l’acquisition de notions et le développement de démarches créatives, etc. le sont.
4
Dès lors, il y a à revenir sur ce que signifie « se représenter » et « représenter ». « Se représenter » est élaborer une image mentale de ce qui existe ou non en réalité. « Représenter » est utiliser des codes et des conventions graphiques pour proposer une image matérielle d’un être, d’un objet ou de toute chose que l’on désire présenter sous une autre forme que celle qui est la sienne au départ. « Se représenter » le virus peut conduire à le décrire tel un monstre gigantesque à cinq têtes, le « représenter » est se tenir au plus près de ce que l’on en sait et à une forme microscopique qui ne suscite pas a priori la peur. « Exposer » au sens de décrire et de « montrer » est utile.
5
À partir de là, il y a à travailler sur l’objectivation de données (entre autres un virus) qui concernent aussi les enfants, tout en explorant les dimensions philosophiques issues du fait de côtoyer ou d’affronter la maladie et la mort dès la maternelle, bien que ce ne soit pas « au programme » ! L’imaginaire collectif, c’est-à-dire le fonds dans lequel il y a à puiser pour découvrir comment d’autres « se les représenter », les imaginent ou nous les donnent à voir ou à comprendre, peut être sollicité avec grand profit. Tel un album, la classe peut se peupler des représentations émanant de chaque élève pour lesquelles chacun mettra en jeu son imagination, c’est-à-dire sa capacité à élaborer des images. Comme ce n’est pas une donnée native, mais acquise, l’adulte aidera à conduire de telles élaborations sans imposer son propre modèle.
6
En désordre, dans cet exposé, mais pas dans une progression pédagogique, je vous propose quelques contenus d’enseignement valables en arts plastiques et en d’autres domaines : montré/caché, visible/invisible, infiniment petit/infiniment grand… La notion de « support » ou de « véhicule » est aussi à clarifier. La circulation du virus appelle aussi à parler de ce qui se déplace d’un endroit à un autre, d’une personne à l’autre avant de se transformer. La transformation ou la modification (par la maladie et bien sûr d’autres sources) est un vecteur créatif, l’observation d’un processus de croissance ou de dépérissement d’une plante de même.
7
Le projet génère un type de croissance. Pourquoi ne pas « Fleurir ensemble ! » en reprenant la proposition de La Grande Lessive® à s’épanouir ensemble ? En effet, la coopération reste un impératif pour combattre une maladie et pour vivre en société. Pourquoi ne pas parler ensemble de l’épreuve traversée en lui donnant des prolongements créatifs ? « Inventons notre histoire ! » détaillée sur le site https://www.lagrandelessive.net/ vous en offre la possibilité. Enfin, après cet épisode d’École à la maison, pourquoi ne pas accorder plus de place à l’école aux arts qui nous ont permis de résister ? « L’après » commence maintenant ! Tous mes vœux vous accompagnent.

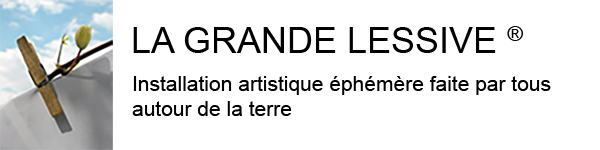


Créons du lien